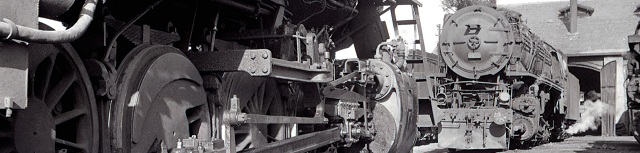un métier: cheminot
Re: un métier: cheminot
Ces 36000 sont de très belles locomotives et de belles reproductions de jouef à Champagnole puis chez HJ. Pas encore eu de soucis mécaniques avec elles  .
.
réseau en U en dcc ; surveillé par modules logiques zelio et RETs jouef.
-

cc7001 - Messages: 794
- Âge: 66
- Enregistré le: 21 Déc 2012, 22:44
- Localisation: presque lyon
Re: un métier: cheminot
Bonjour,
Dans un sujet consacré aux locomotives E 103 de la DB, j’avais fait part de mon appréciation sur les formes de cette locomotive, me doutant bien de la réaction des admirateurs de cet engin. Un intervenant a immédiatement réagi : "La 103 a au moins un pare brise dans le bon sens et une livrée sobre, avec des formes rondes et douces qui respectent la logique aérodynamique. La 6500, avec ses lignes agressives, arbitraires et sa livrée criarde donne plus dans le graf d'immeuble de banlieue..."
Alors, je me suis dit qu’on pourrait ajouter un petit chapitre consacré à l’aérodynamique ferroviaire en général. Comme évoqué en tout début de récit, nous avions été confrontés à des problèmes aérodynamiques avec les turbotrains RTG. Il ne s’agissait pas de problèmes liés au CX général de la rame, mais particulièrement liés aux flux des échappements et des entrées d’air dans les écopes d’aspiration et de ventilation. A cette époque, alors tout jeune cheminot et totalement inexpérimenté en mécanique des fluides, je m’étais rapproché d’un expert du département de la recherche, un certain M. Guiheux…
Il m’avait d’emblée rassuré : "dès l’instant qu’il y a des tampons et des attelages, des rambardes, des phares proéminents etc., ce n’est pas la peine de parler d’aérodynamique, la forme avant globale ne jouant que sur des puoillièmes du CX !". Je n’ai pas de relevés propres aux locomotives (y en a-t-il eu de complets réalisés ?) en tout cas, la figure ci-dessous donnant la décomposition de la résistance à l’avancement d’une rame TGV A est assez instructive.
La surface A représente la masse du train, la surface BV est celle de la résistance au roulement.
La surface CV² est décomposée en divers éléments qui permettent d’apprécier leur importance :
- les bogies : ils ont une part prépondérante dans la résistance à l’avancement. C’est donc un avantage offert par la rame articulée qui, à capacité égale, nécessite moins de bogies qu’une rame classique.
- la surface mouillée : c’est la surface totale du train où là encore la rame articulée à un niveau bénéficie d’un maitre couple moindre grâce à son plancher surbaissé entre les bogies. Dans le cas du TGV Duplex à grand maitre couple, la surface mouillée est plus importante, mais la capacité du train est accrue de 40%.
- les pantographes : à 300 km/h, la trainée de cet appareil n’est pas négligeable. C’est la raison pour laquelle tous les trains à grande vitesse ont les embases de ces appareils et de leur environnement carénées. La trainée aérodynamique d’un pantographe est pratiquement égale à celle d’une planche de la largeur de l’archet et de la hauteur entre la toiture et la caténaire ! C’est la raison pour laquelle la caténaire des TGV à été placée à 4,90 m du niveau du rail (contre 5,50 m plus traditionnellement) et à hauteur constante. De plus à grande vitesse, un seul pantographe alimente les deux motrices. En contrepartie, il faut une ligne de toiture ayant elle aussi sa trainée. D’ailleurs, sur les TGV post TGV-PSE, les supports des isolateurs et les isolateurs eux-mêmes ont été réduits en taille. Pour le record du TGV A à 515,3 km/h, la ligne de toiture avait été remplacée par un câble continu entre les deux motrices afin d’économiser cette trainée.
- les formes AV et AR : on note bien le relativement faible impact sur la résistance à l’avancement dans le cas du TGV A. Il est évident que son influence sera un peu plus élevée dans le cas d’une locomotive classique, mais en tout cas, ce n’est pas elle qui sera la plus rude à combattre en regard de tous les autres facteurs.
Alors peut-on parler de locomotive aérodynamique ? A mon sens, non : car si l’on considère, outre la forme AV perturbée par tous les équipements frontaux, les mauvaises pénétrations dans l’air des pantographes, des équipements et ligne de toiture, des lanterneaux et autres bogies avec toutes les pièces en mouvement de leurs transmissions, on ne peut guère parler de fluidité aérodynamique.
En fait, locomotive "ovoïde" ou "nez cassé", même combat sur le plan aérodynamique ! L’appréciation n’est alors plus qu’une question d’esthétique. Car si l’œuf fait penser à une forme aérodynamique symbole de vitesse, n’oublions pas que Paul Arzens disait des CC 6500 qu’elles symbolisaient le sprinter sortant des starting-blocks ! En fait pour rouler vite, cas des CC 6500 ou CC E 103, on installe les KW qui vont bien et on fait avec ce qui suit, à savoir le nombre de voitures vis-à-vis de leur tonnage et de leurs propres trainées aérodynamiques, notamment à cause des équipements sous châssis, bien supérieures à celles des rames à grande vitesse. Rappelons que les 8,8 MW installés (ramenés actuellement à 8 MW) sur une rame TGV A de 240 m de long lui permettent en toute sérénité de rouler à 300 km/h, alors que le TGV 325 (deux fois plus court et plus léger) avait développé 15,8 MW pour atteindre 515,3 km/h !
Enfin, je n’ai rien contre les CC 6500 et E 103, je leur préfère simplement les BB MTE et les BB 36000, uniquement pour une question esthétique.
2B.
Dans un sujet consacré aux locomotives E 103 de la DB, j’avais fait part de mon appréciation sur les formes de cette locomotive, me doutant bien de la réaction des admirateurs de cet engin. Un intervenant a immédiatement réagi : "La 103 a au moins un pare brise dans le bon sens et une livrée sobre, avec des formes rondes et douces qui respectent la logique aérodynamique. La 6500, avec ses lignes agressives, arbitraires et sa livrée criarde donne plus dans le graf d'immeuble de banlieue..."
Alors, je me suis dit qu’on pourrait ajouter un petit chapitre consacré à l’aérodynamique ferroviaire en général. Comme évoqué en tout début de récit, nous avions été confrontés à des problèmes aérodynamiques avec les turbotrains RTG. Il ne s’agissait pas de problèmes liés au CX général de la rame, mais particulièrement liés aux flux des échappements et des entrées d’air dans les écopes d’aspiration et de ventilation. A cette époque, alors tout jeune cheminot et totalement inexpérimenté en mécanique des fluides, je m’étais rapproché d’un expert du département de la recherche, un certain M. Guiheux…
Il m’avait d’emblée rassuré : "dès l’instant qu’il y a des tampons et des attelages, des rambardes, des phares proéminents etc., ce n’est pas la peine de parler d’aérodynamique, la forme avant globale ne jouant que sur des puoillièmes du CX !". Je n’ai pas de relevés propres aux locomotives (y en a-t-il eu de complets réalisés ?) en tout cas, la figure ci-dessous donnant la décomposition de la résistance à l’avancement d’une rame TGV A est assez instructive.
La surface A représente la masse du train, la surface BV est celle de la résistance au roulement.
La surface CV² est décomposée en divers éléments qui permettent d’apprécier leur importance :
- les bogies : ils ont une part prépondérante dans la résistance à l’avancement. C’est donc un avantage offert par la rame articulée qui, à capacité égale, nécessite moins de bogies qu’une rame classique.
- la surface mouillée : c’est la surface totale du train où là encore la rame articulée à un niveau bénéficie d’un maitre couple moindre grâce à son plancher surbaissé entre les bogies. Dans le cas du TGV Duplex à grand maitre couple, la surface mouillée est plus importante, mais la capacité du train est accrue de 40%.
- les pantographes : à 300 km/h, la trainée de cet appareil n’est pas négligeable. C’est la raison pour laquelle tous les trains à grande vitesse ont les embases de ces appareils et de leur environnement carénées. La trainée aérodynamique d’un pantographe est pratiquement égale à celle d’une planche de la largeur de l’archet et de la hauteur entre la toiture et la caténaire ! C’est la raison pour laquelle la caténaire des TGV à été placée à 4,90 m du niveau du rail (contre 5,50 m plus traditionnellement) et à hauteur constante. De plus à grande vitesse, un seul pantographe alimente les deux motrices. En contrepartie, il faut une ligne de toiture ayant elle aussi sa trainée. D’ailleurs, sur les TGV post TGV-PSE, les supports des isolateurs et les isolateurs eux-mêmes ont été réduits en taille. Pour le record du TGV A à 515,3 km/h, la ligne de toiture avait été remplacée par un câble continu entre les deux motrices afin d’économiser cette trainée.
- les formes AV et AR : on note bien le relativement faible impact sur la résistance à l’avancement dans le cas du TGV A. Il est évident que son influence sera un peu plus élevée dans le cas d’une locomotive classique, mais en tout cas, ce n’est pas elle qui sera la plus rude à combattre en regard de tous les autres facteurs.
Alors peut-on parler de locomotive aérodynamique ? A mon sens, non : car si l’on considère, outre la forme AV perturbée par tous les équipements frontaux, les mauvaises pénétrations dans l’air des pantographes, des équipements et ligne de toiture, des lanterneaux et autres bogies avec toutes les pièces en mouvement de leurs transmissions, on ne peut guère parler de fluidité aérodynamique.
En fait, locomotive "ovoïde" ou "nez cassé", même combat sur le plan aérodynamique ! L’appréciation n’est alors plus qu’une question d’esthétique. Car si l’œuf fait penser à une forme aérodynamique symbole de vitesse, n’oublions pas que Paul Arzens disait des CC 6500 qu’elles symbolisaient le sprinter sortant des starting-blocks ! En fait pour rouler vite, cas des CC 6500 ou CC E 103, on installe les KW qui vont bien et on fait avec ce qui suit, à savoir le nombre de voitures vis-à-vis de leur tonnage et de leurs propres trainées aérodynamiques, notamment à cause des équipements sous châssis, bien supérieures à celles des rames à grande vitesse. Rappelons que les 8,8 MW installés (ramenés actuellement à 8 MW) sur une rame TGV A de 240 m de long lui permettent en toute sérénité de rouler à 300 km/h, alors que le TGV 325 (deux fois plus court et plus léger) avait développé 15,8 MW pour atteindre 515,3 km/h !
Enfin, je n’ai rien contre les CC 6500 et E 103, je leur préfère simplement les BB MTE et les BB 36000, uniquement pour une question esthétique.
2B.
- Undertaker
- Bavard
Re: un métier: cheminot
Je ne comprends pas, si on ne parle que de pouillèmes, pourquoi justement être passé des MTE, a la face avant droite comme la justice, aux 36000, a l'avant lissé jusqu'a rentrer les rambardes pour les rendre affleurantes et caréner la toiture, ça ne serait que de l'optimisation ? Jaimerais bien quand même avoir des résultats concrets pour ce genre de cas.
- BB63670
- Bavard
Re: un métier: cheminot
Ah la BB 36000 !
Pour moi, l'aboutissement de la locomotive universelle et la fin du design ferroviaire ....
Ce sont pour moi les plus belles BB de la SNCF, de longueur intermédiaire entre la moche Sybic et la puissante CC 6500.
La mise au point a été laborieuse et leur service peu glorieux, il faudra attendre Thello pour les voir enfin en tête de rames voyageurs ....
L'archétype est à mon gôut la rouge à 3 pantos.
Les 36001 à 36024 sont sorties de construction avec seulement 2 pantos , elles ont été retrofitées par la suite.
La première rouge 3 pantos de construction fût la 36025 en septembre 1999, je les voyais sortir toutes neuves de Belfort ...
La première verte, 36031, sortira en mars 2000, les vertes n'avaient pas la classe des rouges .
Pour moi, l'aboutissement de la locomotive universelle et la fin du design ferroviaire ....
Ce sont pour moi les plus belles BB de la SNCF, de longueur intermédiaire entre la moche Sybic et la puissante CC 6500.
La mise au point a été laborieuse et leur service peu glorieux, il faudra attendre Thello pour les voir enfin en tête de rames voyageurs ....
L'archétype est à mon gôut la rouge à 3 pantos.
Les 36001 à 36024 sont sorties de construction avec seulement 2 pantos , elles ont été retrofitées par la suite.
La première rouge 3 pantos de construction fût la 36025 en septembre 1999, je les voyais sortir toutes neuves de Belfort ...
La première verte, 36031, sortira en mars 2000, les vertes n'avaient pas la classe des rouges .
- CC 6574
- Bavard
Re: un métier: cheminot
J'ai acheté il y a peu une rouge, a deux pantos. J'aime bien la mettre devant des rames voyageurs, une situation que j'aurais bien voulu voir... Avant les Thello.
- BB63670
- Bavard
Re: un métier: cheminot
Moi, je viens de m'acquérir une verte, la 36060. Me reste à trouver des rouges à un prix décent. Par contre, j'ai remarqué que souvent il y a un défaut de l'emboitage du nez sur la caisse donnant un léger jour. Vous avez le même problème sur vos Jouef/HJ. Leurs cousines belgo-luxembourgeois, ne sont pas vilaines non plus.
Bref, cette première tranche, je l'ai souvent photographié (ou filmé) ainsi que des amis mais ça devient une rareté dans le nord : Album BB 36000
Bref, cette première tranche, je l'ai souvent photographié (ou filmé) ainsi que des amis mais ça devient une rareté dans le nord : Album BB 36000
- jObiwan
- Messages: 359
- Âge: 51
- Enregistré le: 16 Juin 2013, 06:49
- Localisation: Lille / Hazebrouck / Dunkerque
Re: un métier: cheminot
Je trouve que même pour le service marchandise, elles ont la classe !
- Fichiers joints
-

Double Dabeg - Messages: 771
- Enregistré le: 14 Juil 2015, 14:26
Re: un métier: cheminot
BB63670 a écrit:
...des MTE, a la face avant droite comme la justice, ...
Elles ont au contraire une face plutôt arrondie, bien que verticale.
Undertaker, ta démonstration est intéressante (et convaincante). Je note une grande différence avec le monde automobile où l'aérodynamique joue un rôle majeur quand il s'agit d'optimiser la vitesse avec la puissance disponible (ou la consommation mais cela revient au même) avec en plus la nécessité de ne pas faire décoller un engin légéer quand on atteint les grandes vitesses (Plus de 300 km/h). Toutefois je constate qu'on a aussi fait des effort aérodynamique sur les camions qui doivent plus se rapprocher des trains.
En tout cas nous nous rapprochons par notre goût partagé des BB MTE et des 36000.
Une brute qui tourne en rond ne va pas plus loin que deux intellectuels assis (Michel Audiard revisité)
-

Pierre bis - Bavard
- Messages: 2448
- Enregistré le: 05 Oct 2010, 15:23
Re: un métier: cheminot
Undertaker a écrit:Bonjour,
Dans un sujet consacré aux locomotives E 103 de la DB, j’avais fait part de mon appréciation sur les formes de cette locomotive, me doutant bien de la réaction des admirateurs de cet engin. Un intervenant a immédiatement réagi : "La 103 a au moins un pare brise dans le bon sens et une livrée sobre, avec des formes rondes et douces qui respectent la logique aérodynamique. La 6500, avec ses lignes agressives, arbitraires et sa livrée criarde donne plus dans le graf d'immeuble de banlieue..."
2B.
Excessif, mais formulé de manière plaisante et pas entièrement faux.
Une brute qui tourne en rond ne va pas plus loin que deux intellectuels assis (Michel Audiard revisité)
-

Pierre bis - Bavard
- Messages: 2448
- Enregistré le: 05 Oct 2010, 15:23
Re: un métier: cheminot
Undertaker a écrit:... n’oublions pas que Paul Arzens disait des CC 6500 qu’elles symbolisaient le sprinter sortant des starting-blocks ! ...
2B.
En même temps j'ai lu dans un ouvrage consacré aux 6500 Qu'Arzens n'avait jamais aimé les pare-brises inversés des 6500 et avait même milité pendant les études pour qu'il soient remis dans le bon sens. Après, en bon publicitaire qu'il était au fond (pas que, mais aussi) il a trouvé un discours pour trouver beau un objet qu'il n'appréciait pas tant que ça à la base.
A la même époque que la production des 6500, Alsthom a produit de grosse CC destinées à la Chine. Je vais sûrement en faire hurler certains mais j'en ai vu une photo et je les apprécie plus que les 6500.
Une brute qui tourne en rond ne va pas plus loin que deux intellectuels assis (Michel Audiard revisité)
-

Pierre bis - Bavard
- Messages: 2448
- Enregistré le: 05 Oct 2010, 15:23
Retourner vers Histoire ferroviaire
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités