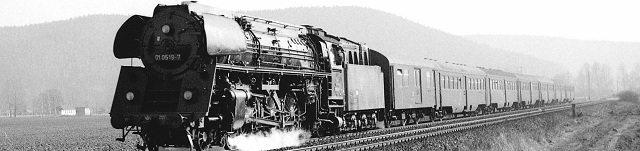H110
3-1-5-3) Les locomotives de série 56 d’origine saxonne
3-1-5-3-1) Série 565 - anciennement sä. IX V et Série 566- anciennement sä. IX HV
Une locomotive atypique en Allemagne.
Les résultats d’exploitation peu satisfaisants qu’avaient obtenus les chemins de fer saxons avec la locomotive de catégorie IV (B’Bn4v), de conception Mallet, les avaient amenés à renoncer aux locomotives articulées. En conséquence, suivant en cela la tendance en vigueur auprès des autres compagnies de chemins de fer allemandes, ils s’étaient tournés vers une machine à la disposition d’essieux 1’D.
La machine recherchée devait être équilibrée en puissance, dotée d’une bonne inscription en courbe, tout en affichant une masse à l’essieu aussi petite que possible afin de ménager les infrastructures et les ponts.
Le nouvelle locomotive qu’allait livrer le constructeur Hartmann en 1902 était remarquable à maints égards :
L’entraxe des essieux accouplés atteignait 5340 mm. Le dernier essieu accouplé avait été repoussé à l’arrière de la chaudière, pratiquement au droit de la porte du foyer et était constitué d’un axe creux radialement réglable de conception Klien-Lindner. Avec un jeu latéral de ± 30 mm de l’essieu Klien-Lindner associé à un jeu latéral de ± 17 mm du deuxième essieu accouplé ainsi qu’avec le jeu de ± 50 mm de l’essieu directeur avant, la machine pouvait aborder des courbes de rayon de 170 m sans contraintes.
L’essieu Klien-Lindner était disposé sur un cadre externe. Cette disposition libérait de la place pour une large boîte à feu d'une surface de 3,17 m², apte à la combustion de lignite.
Extérieurement, la machine se caractérisait encore par la canalisation de collecte de vapeur longue de 5 m située sur le sommet de la chaudière dont la fonction était d’agrandir le secteur de séchage de la vapeur. Il y avait toutefois un bémol à ce système : la différence de dilatation entre le corps de la chaudière et le tuyau de collecte de vapeur entraînait des fuites récurrentes au niveau des manchons de raccordement. En outre, la canalisation rendait difficile l’accès à l’arrière de la chaudière Belpaire pour les entretiens ; si bien que lors du remplacement ultérieur de ces chaudières, la canalisation de vapeur allait être intégrée à la chaudière principale en liaison avec deux dômes de vapeur classiques.
Les deux premières machines livrées par Hartmann en 1902 étaient des prototypes sortis d’usine sous les numéros 2650 et 2651 et immatriculées aux chemins de fer saxons 751 et 752. La locomotive n° 751 possédait dans la boîte à fumée (à l’avant de la cheminée) un système de séchage de la vapeur de conception Klien où la vapeur en provenance du cylindre à haute à pression était séchée en chemin vers le cylindre à basse pression. Comparée avec la 752 qui n’était pas équipée de sécheur, la 751 consommait nettement moins d’eau.
Sous les numéros 2850 à 2853 et 2862 à 2866, Hartmann livrait ensuite en 1904 neuf locomotives supplémentaires formant la catégorie IX V que la Saxe immatriculait 753 à 756 et 757 à 761. Ces locomotives étaient également équipées du système de séchage de vapeur de conception Klien. Une dernière livraison de neuf locomotives supplémentaires en 1906 (numéros 2918 à 2926) complétait la série pour l’amener à vingt machines. Immatriculées 762 à 770, elles avaient également un système de séchage de vapeur mais de plus petite taille, installé dans la partie supérieure de la boîte à fumée.
A partir de 1907 et en 1908, 30 nouvelles machines allaient encore être fabriquée mais cette fois ci à vapeur surchauffée. Sorties d’usine comme 3124 à 3153, immatriculées 771 à 800, elles étaient équipées d’un réchauffeur-surchauffeur Schmidt. Les alésages de cylindres à 530/700 mm avaient été conservés mais la pression de chaudière avait été élevée de 14 à 15 bars. A la place des glissières présentes sur les machines à vapeur humide, les machines à vapeur surchauffée étaient équipées de tiroirs de pistons à alimentation interne. Ces 30 machines formèrent la catégorie IX HV. Comme on pouvait s’y attendre, la comparaison des performances des machines était nettement à l’avantage des machines à surchauffe, principalement aux vitesses les plus élevées.
Le petit diamètre des roues motrices (1260 mm) ne facilitait pas le fonctionnement de l’embiellage. Comme l’essieu moteur était raccordé à deux bielles d’accouplement, le passage dans une contrecourbe trop prononcée les aurait déportées hors des limites du cadre. Comme on ne souhaitait pas équiper la machine d’un entraînement interne, pour compenser les torsions, on équipa l’essieu arrière d’un volant de conception Joy sur le modèle de la transmission Hawthorn-Kitson.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Les 50 machines des catégories IX V et IX HV remplirent jusqu’au milieu de la première guerre mondiale les missions pour lesquelles les chemins de fer saxons les avaient commandées. Leurs performances étaient bonnes même au-delà de la vitesse commerciale de 50 km/h. On trouve dans le cahier de service de la DRG de 1924 des missions pour des trains tractés à 65 km/h. Elle assureront régulièrement le service des marchandises rapides à 60 km/h.
La DRG intégra 16 des 20 machines IX V comme série 565 sous les numéros 56 501 à 56 516 et 25 des 30 machines IX HV comme série 566 sous les numéros 56 601 à 56 625. Elles assurèrent le trafic des marchandises sur les lignes saxonnes durant toutes les années 20 et furent équipées de freins à air comprimé de type Westinghouse. Elles allaient également recevoir des préchauffeurs et des pompes d’alimentation, signe que la DRG leur réservait un futur de longue durée. On constata cependant une usure prématurée des axes creux nécessitant d’en réduire le jeu latéral. Les machines furent radiées en 1932.
Série 565
Catégorie : 1’Dn2v
Distribution : G45.15
Diamètre des roues motrices : 1260 mm
Vitesse maxi : 50 km/h
Fabricant : Hartmann
Première mise en service : 1902
Tender : sä.3T9 avec 4t de charbon
Nombre total construit : 20
Nombre intégré à la DRG : 16
Numérotation : 56 501 à 56 516
Dates de dernière réforme : 1932
Série 566
Catégorie : 1’Dh2v
Distribution : G45.15
Diamètre des roues motrices : 1260 mm
Vitesse maxi : 50 km/h
Fabricant : Hartmann
Première mise en service : 1907
Tender : sä.3T12 avec 6t de charbon
Nombre total construit : 30
Nombre intégré à la DRG : 25
Numérotation : 56 601 à 56 625
Dates de dernière réforme : 1932